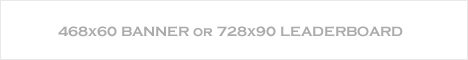Je ne me suis jamais réellement exprimé publiquement sur mon activité au sein de KAMAYITI.COM.
Sans doute parce que Kamayiti n’a jamais été, à mes yeux, un outil d’auto-satisfaction ni un support de promotion personnelle.
Lorsque je crée Kamayiti en 2003, mon intention est claire : donner la parole à la communauté africaine et haïtienne de France, dans un paysage médiatique où elle est largement marginalisée, caricaturée ou ignorée. À cette époque, je suis en formation en communication digitale. J’ai eu la chance d’être formé par des professionnels exigeants, aujourd’hui disparus, emportés par la violence qui frappe Haïti. Je leur dois beaucoup.
Kamayiti, je l’ai construit de mes propres mains, des premiers codages HTML jusqu’à la production des contenus. Mon credo était simple et radical : aller sur le terrain, interviewer, écrire, cadrer, enregistrer le son, documenter. Être présent, au plus près des faits. J’étais à la fois rédacteur, cadreur, preneur de son, monteur. Un fonctionnement exigeant, parfois éprouvant, mais nécessaire pour bâtir un média indépendant et crédible.
Ce mode de travail relevait d’un choix éditorial assumé. Il ne signifiait ni isolement intellectuel, ni absence de relais, mais une indépendance totale dans le traitement de l’information. Cette indépendance m’a parfois valu d’être confondu avec les sujets ou les personnes que je traitais — confusion révélatrice de la difficulté, dans certains contextes, à distinguer observation journalistique et engagement perçu.
Kamayiti, c’était aussi une succession de rencontres, parfois brèves, parfois marquantes.
Des personnalités qui, pour la plupart, ne me connaissaient pas, mais que j’ai eu l’honneur de croiser et de documenter lors de forums associatifs, de conférences, de mobilisations citoyennes.
C’était Youssoupha, venu soutenir des familles africaines expulsées de leur logement.
C’était Christiane Taubira, expliquant publiquement la portée de la loi sur la reconnaissance des faits de l’esclavage.
C’était Stomy Bugsy, que j’avais admiré à travers ses textes, et que j’ai vu se produire, simplement, dans le réel.
C’était la fille de Malcolm X, rencontrée à Paris lors d’une présentation autour d’un projet qu’elle défendait.
C’était Claude Ribbe, à propos de son travail sur Napoléon.
C’était Omotude, dans le cadre d’Africamaat.
Des conférenciers africains, des intellectuels, des artistes, des responsables associatifs et politiques.
C’était aussi Dieudonné, à une époque où ses démêlés avec les autorités posaient déjà la question des tensions, des lignes de fracture et des limites du débat public.
À tous, je n’ai rien demandé d’autre que quelques mots, un regard, une parole.
Je n’étais ni juge, ni porte-voix, ni attaché de presse.
J’étais là pour tendre le micro, observer, documenter, laisser une trace.
Je ne suis pas naïf. Exercer une activité journalistique indépendante en France, sans adossement institutionnel, relève du défi permanent. Le secteur est verrouillé, encadré, parfois stratégique. Je l’ai compris avec le temps. Ceux qui ont perçu un intérêt dans mon travail se sont parfois rapprochés de moi, souvent pour en bénéficier, sans réelle réciprocité. J’ai pourtant continué, convaincu que l’essentiel était de faire exister ce média.
C’est lors de ma rencontre avec Kemi Seba que les choses se compliquent. Entre 2006 et 2007, la couverture de certains sujets — le fanatisme communautaire, la politique française en Afrique, le système de la Françafrique — devient sensible. À cette période, j’ai été interpellé à plusieurs reprises par les forces de l’ordre, sans que des raisons claires ne me soient communiquées. Lors d’une manifestation que je couvrais, caméra à la main, j’ai même été mis en joue par un policier. Malgré mes demandes, aucune explication ne m’a jamais été donnée. Ces épisodes ont marqué un tournant : ils m’ont rappelé que documenter certains sujets, hors cadre institutionnel, expose à des risques réels, et que la liberté d’informer reste fragile selon les contextes.
Comme l’a souligné Albert Londres, célèbre journaliste français :
"Être journaliste, c’est s’exposer chaque jour à des dangers, parfois invisibles, parfois mortels, pour révéler la vérité au public."
Progressivement, j’ai pris conscience des limites humaines et structurelles d’un tel engagement mené seul.
Je n’ai pour autant jamais cessé d’intervenir au sein de la communauté africaine en France : Sénégal, Cameroun, Tchad, Soudan. Associations, manifestations, crises politiques. En 2010, la crise ivoirienne m’a confronté de nouveau à la réalité des lignes éditoriales autorisées. Interroger le traitement réservé à Laurent Gbagbo n’était pas un sujet recevable. Il fallait passer son chemin. J’ai appris, à mes dépens, que pour un Africain subsaharien, exercer ce métier implique d’encaisser un choc constant.
C’était cela, Kamayiti.
Des erreurs, des services rendus, des tensions provoquées.
De belles rencontres, de mauvaises aussi.
La loyauté, la trahison, la violence d’un monde en mouvement.
Un tel travail nécessite une véritable équipe, une organisation solide, une structure capable de durer. J’ai poursuivi encore quelque temps la production de reportages, tout en me recentrant progressivement sur la photographie — et sur l’écriture.
Aujourd’hui, je ferme les portes de KAMAYITI.COM.
Pas par effacement.
Mais parce qu’un cycle se termine.
Je fais cette mise au point en rencontrant à Paris d’anciennes connaissances sénégalaises, qui pensaient que je les avais oubliées. Ces retrouvailles marquent la fin d’un chapitre et l’ouverture d’un nouveau, dans lequel je continue à explorer et documenter les cultures, l’histoire et les voix de ma communauté, sous une autre forme.
Le travail, lui, ne s’arrête pas.
Il change simplement de forme.